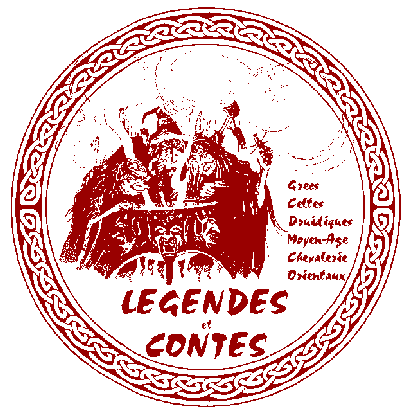
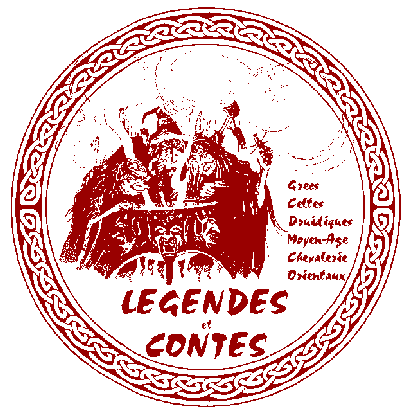
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FENRIS ET LE GEANT SANGRIFELD :
Avant d'être un monastère, puis une forteresse qui domine la baie, la Tour Rouge était la demeure d'un géant nommé Sangrifeld. C'est lui-même qui avait apporté toutes les pierres pour former cette butte. Sa force était prodigieuse, mais il lui avait fallu beaucoup de temps pour les amener et les amasser en cet endroit d'où il pouvait surveiller tout le pays. De plus, il se terrait dans une grotte qu'il avait aménagée, ce qui lui permettait de surprendre tous les intrus qui se risquaient jusque-là. Alors, il se précipitait hors de la grotte et ceux qui ne pouvaient s'échapper étaient broyés entre les mains puissantes.
Mais c'était autrefois, car personne ne se risquait plus à fréquenter ce rivage sur lequel Sangrifeld avait tous les droits. Les voyageurs qui longeaient la côte se détournaient de leur chemin et n'osaient même plus traverser le bourg d’Umhlazi, tant la terreur qu'inspirait le géant était grande. Quant aux bateaux, ils passaient au large et allaient se réfugier dans le port de Guydroi, là où Sangrifeld n'allait jamais par suite d'un arrangement qu'il avait fait avec les habitants : ils devaient en effet, chaque année, lui remettre un tribut en or et en argent ; moyennant quoi, le géant les laissait tranquilles.
Mais il dévastait la côte jusqu'au Cap Lézard et remontait même vers l'intérieur jusqu'à atteindre les portes de Slotar. Quand il apercevait un troupeau de vaches, il s'en emparait et le ramenait jusqu'à sa butte : là, il en faisait sa nourriture favorite, car il aimait beaucoup la viande, et comme il avait un gros appétit, il lui fallait sans cesse partir en quête de nouvelles proies. Tous ceux des alentours étaient bien malheureux de cette situation, mais ils ne pouvaient guère se défendre contre les exactions de Sangrifeld : on eût envoyé une troupe armée qu'il l'eût dispersée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'était déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, et les audacieux n'avaient dû leur salut que dans une fuite précipitée, affolés qu'ils étaient par les hurlements de rage que poussait Sangrifeld en s'efforçant de les rattraper.
A cette époque, il y avait à Umhlazi, un jeune homme du nom de Fenris. Son père avait été ruiné à cause du géant, et lui-même se lamentait, ne supportant plus la présence de ce monstre qu'il jugeait encore plus odieux que dangereux. Car il était brave ; ce Fenris, et il n'avait peur de rien. I1 lui arrivait souvent de dire qu’il debarrasserait le pays de Sangrifeld mais personne ne le prenait au sérieux, mettant sa vantardise au compte de sa jeunesse et de son inexperience.
Cela ne l'empêchait nullement de sortir toutes les nuits de la maison familiale et d'aller sur le rivage, se cacher entre deux rochers afin de surveiller les agissements du géant. Il attendait l'occasion favorable mais se demandait en fait de quelle manière il pourrait vaincre un adversaire aussi redoutable. Or, une nuit, le géant s'était endormi à l'entrée de son antre, fatigué et repus. Le jeune Fenris décida d'agir immédiatement. Prenant le soin de vérifier à chaque instant si Sangrifeld n'était pas sur le point de se réveiller, il creusa, pendant toute la nuit, avec acharnement, une large et profonde fosse à mi-chemin entre la butte et le rivage, là où, en se retirant, la mer laisse de grandes étendues de sable fin.
II y avait une fois, dans le village de Sugny, au sud de la vallée de la Semois, une grande et belle fille d'une vingtaine d'années, qui n'avait jamais eu d'amoureux. Elle avait une taille avantageuse, une démarche engageante, de beaux cheveux, de jolis yeux, de belles dents, enfin tout ce qui plaît d'habitude à tous les prétendants du monde. Cependant, aucun des jeunes gens du village ne lui avait fait la moindre cour. Et chaque fois qu'un étranger, en la voyant, avait laissé entendre que c'était une belle fille, il avait reçu cette immuable réponse: « C'est une sorcière ».
C'était en effet le bruit qui courait dans tout le village, non pas à cause d'elle, dont la conduite était irréprochable, mais à cause de sa mère. On prétendait en effet que celle-ci était devenue sorcière dans sa jeunesse parce que, se trouvant au chevet d'une vieille femme mourante qui était sorcière, elle avait commis l'imprudence de lui toucher la main. Sur le moment, la chose n'avait pas été ébruitée et elle avait pu trouver un mari sans peine. Mais à peine le mariage avait-il était consommé que celui-ci était tombé malade et avait fini par mourir de langueur. Dans ces conditions, il était normal que la fille fût devenue sorcière à son tour, car chacun sait que la « chose » se passe par le toucher. Et il était non moins certain que le téméraire qui aurait osé la fréquenter de trop près serait voué à une mort prochaine, comme l'avait été son père.
Un jour, cependant, un jeune homme, originaire de Namur, était venu s'installer dans le village pour y travailler. Il fut frappé par la beauté et l'apparence de cette fille et, depuis lors, il ne pensait plus qu'à elle. L'un de ses camarades, auquel il avait fait confidence de cet intérêt passionné, lui révéla qu'elle était sorcière, mais il haussa les épaules. « La sorcellerie, ça n'existe pas ! » répondit-il. « Ce ne sont que de vaines superstitions inventées par les prêtres pour mieux justifier leur fonction ! »
Car non seulement le jeune homme de Namur était sceptique, mais il était aussi très anticlérical et n'allait jamais à l'église. Et, malgré l'avertissement de son camarade, il n'en continua pas moins à soupirer après la belle. Il commença à la fréquenter, et l'on parla même mariage. Le jeune se trouva au comble du bonheur et il attendait avec impatience le jour où ce projet serait enfn réalité. La famille du jeune homme, quoiqu'éloignée, fut mise au courant. Ses parents étaient moins sceptiques que lui, car ils venaient de la campagne et savaient à quoi s'en tenir sur les envoûtements que pratiquent les sorciers, surtout dans une région comme celle de Sugny, qui a mauvaise réputation de ce point de vue-là. Ils voyaient donc d'un assez mauvais oeil ce projet. Mais l'amoureux était très entêté dans sa résolution, et comme la fille et la mère faisaient tout leur possible pour l'attirer, les arrangements furent bientôt mis au point et la date du mariage fixée. Et, chaque soir, le jeune homme allait faire sa cour à sa fiancée, sous la surveillance de la mère, bien entendu.
Mais les camarades du jeune homme, à force de répéter leurs avis sur la jeune fiile, finirent par provoquer quelques doutes dans l'esprit du fiancé. Il se mit à se poser certaines questions, auxquelles d'ailleurs il n'avait nulle envie de répondre. Il avait en effet remarqué que, lorsqu'il s'attardait certains soirs dans la maison de sa fiancée, on 1e congédiait avec une précipitation suspecte en donnant pour raison qu'il était près de minuit. Or, on lui avait bien dit que c'était à minuit que se réunissaient les sorcières pour assister au sabbat. Et il avait beau ne pas croire à ces choses-là, il décida d'en avoir le coeur net. I1 arriva donc un soir, comme d'habitude, chez sa fiancée, mais il prétendit être très fatigué. Au cours de la conversation, il s'arrangea pour avoir les apparences de celui qui va s'endormir. Puis il fit vraiment semblant d'être plongé dans un profond sommeil. C'était le soir du vendredi. Or, on sait que c'est le jour de la semaine où aucune sorcière ne peut se dispenser d'aller au sabbat. Aussi, dès que la soirée fut un peu trop avancée, la mère et la fille essayèrent de réveiller le jeune homme, mais elles comprirent vite que ce n'était pas possible. Il ronfïait bruyamment et avec une grande régularité. Mais cela ne l'empêchait pas de regarder ce qui se passait entre ses paupières à peine closes, et d'écouter tout ce qui se disait. Il constata que plus l'heure de minuit approchait, plus les deux femmes manifestaient de la nervosité et même de l'inquiétude.
Elles tentèrent un dernier effort afin de le réveiller, puis elles discutèrent à voix basse. Enfin, elles semblèrent prendre une décision :elles éteignirent la lumière, et seuls quelques tisons qui brûlaient encore dans l'âtre permirent au jeune homme de voir ce qu'elles faisaient. Il en fut si stupéfait qu'il faillit bien se lever et pousser un cri.
En effet, il les vit sortir un pot de l'une des armoires. Elles le placèrent sur la table, puis elles se dépouillèrent l'une et l'autre de leurs vêtements et furent rapidement nues. Elles prirent alors chacune un peu de la pommade qui était dans le pot et s'en enduisirent tout le corps bien soigneusement, de façon à ne laisser aucune partie qui ne fût recouverte. Elles commencèrent par se frotter les pieds, puis les jambes, les cuisses. le ventre, la poitrine et le dos, sans oublier le cou et la tête. Et, tout en se livrant à cette étrange opération, elles répétaient comme une incantation cette simple phrase :« Sur la feuille ! »
Elles venaient de terminer de s'enduire tout le corps, quand, à la grande frayeur du jeune homme, elles se transformèrent l'une et l'autre en chouettes. Aussitôt, en poussant un long hululement, elles s'engouffrèrent dans la cheminée et disparurent. Dès qu'il se retrouva seul, le jeune homme se leva et ralluma la lampe. II examina soigneusement les moindres recoins de la pièce, les moindres meubles, et s'assura qu'il n'avait pas été le jouet d'une hallucination. Son tempérament le poussait à ne pas croire â ce qu'il avait vu, mais il dut se rendre à l'évidence: les vêtements des deux femmes étaient là, sur une chaise, encore tièdes de la chaleur de leurs corps, et sur la table, il y avait le pot, qui était resté ouvert. Il contenait une sorte de pommade noirâtre et d'une odeur fétide. Aucun doute n'était possible : sa fiancée et la mère de celle-ci s'étaient transformées en chouettes et s'étaient envolées par la cheminée. C’étaient donc deux sorcières, c'était incontestable.
Minuit sonna à ce moment-là. Le jeune homme attendit que quelque chose se passât dans la pièce où il se trouvait. Mais rien ne se produisit. II pensa qu’il ne risquait rien, puisque c'était l'heure où l'on disait que les sorcières étaient réunies au sabbat. Mais il eut tout à coup une étrange idée. « Au fait ! se dit-il, si je profitais de la pommade pour aller, sous une forme de chouette, voir ce que font ma fiancée et ma future belle-mère? »
Sans plus se poser de question, il se déshabilla avec une grande fébrilité, il plongea ses doigts dans le pot et s'enduit de pommade de la même manière qu'il avait vu faire aux deux femmes, en prononçant la phrase qu'il avait entendue. Mais, en rêalité, il avait mal entendu, car au lieu de dire « sur la feuille », il dit « sous la feuille ».
I1 avait à peine terminé de s'oindre entièrement le corps en prononçant sans arrêt les paroles magiques qu'il se sentit devenir plus léger. Des plumes apparurent sur ses bras, sur ses jambes et sur son torse. Il était vraiment devenu une chouette. A son tour, après avoir battu des ailes, il s'envola par la cheminée et se retrouva dans le ciel nocturne où brillaient des myriades d'étoiles lointaines.
Mais cette sensation de bien-être qui le saisit un instant ne dura pas. Sans pouvoir résister, il retomba près du sol, au-dessous des branches, presque à ras de terre, frôlant les grandes herbes de la prairie. Tant que ce fut des herbes, cela lui sembla, somme toute, très agréable, mais quand il dut pénétrer dans les taillis, il fut aux prises avec de terribles difficultés. En effet, s'il volait avec aisance sur la terre nue, caressé par les herbes et les fleurs, il en allait tout autrement quand il devait traverser des buissons. Là, les épines le blessaient atrocement, marquant profondément sa chair qui, pour être recouverte de plumes, n'en était pas moins sujette à la douleur. Quant aux branches des arbres, et même des simples arbustes, elles le cognaient terriblement au passage, et il fut bientôt couvert d'êcorchures et de contusions. Il crut qu'il allait tomber dans quelque abîme dissimulé sous lui et croyait sa dernière heure venue. Mais tout à coup, il entendit le coq chanter. I1 s'effondra lourdement sur la terre humide et retrouva immédiatement sa forme humaine.
I1 était étendu en plein champ, moulu, déchiré, saignant de mille plaies, tout nu et dans la plus misérable situation du monde. Il se releva comme il put et, en boitant, en se traînant péniblement, il regagna sa maison avant que quiconque pût le voir. Heureusement il n'y avait encore personne dans les rues du village, et c'est avec un immense soulagement qu'il se précipita chez lui.
Une fois rentré, il n'eut que la force de se traîner sur son lit, en proie à une violente fièvre. I1 fut malade pendant plusieurs jours, et ceux qui vinrent le soigner l'entendirent souvent se plaindre et murmurer des paroles incohérentes. Mais dès qu'il fut guéri, il quitta son travail sans donner aucune explication et retourna chez ses parents à Namur, n'ayant même pas osé réclamer à son ex-fiancée et à sa mère les vêtements qu'il avait laissés dans leur maison.
Quant à la fiancée, elle ne se maria jamais et resta jeune fille. Mais â la mort de sa mère, elle s'en alla dans un autre pays, et, depuis, plus personne n'en entendit jamais parler.
C'était dans le temps, lorsque seuls les oiseaux volaient dans le ciel et que la nuit était noire dans les campagnes. II y avait, dans un village, aux environs de Daoulas ou de Saint-Urbain, à moins que ce ne fût de Dirinon, trois bons camarades qui se retrouvaient souvent le soir, après une dure journée de labeur. Lorsque le temps le per- mettait, ils allaient se promener sur les landes, et lorsqu’il pleuvait ou faisait trop froid, ils se réfugiaient chez l'un d'entre eux pour boire une bolée et deviser de choses et d'autres. Et, dans tout le pays, on ne tarissait pas d’éloges sur eux en raison de leur sérieux et de leur vie rangée. D'ailleurs, beaucoup de filles espéraient secrètement qu’ils jettent les yeux sur elles, persuadées qu'ils feraient de très bons maris.
Or, un soir d'automne où le ciel était maussade comme chagriné, où le vent soufflait en rafales, l'un des trois dit aux autres : « - Si nous allions faire une partie de cartes à l'auberge? »
La proposition fut tout de suite adoptée, et, sans plus tarder, ils se dirigèrent vers l'auberge la plus voisine. Pour s'y rendre, il fallait passer par la Croix-Rouge, qui se dressait à l'intersection de trois chemins, en pleine lande sauvage, loin de toute habitation. La nuit était déjà fort avancée, elle était très sombre, car la lune n'était pas encore levée et les nuages chahutaient dans le ciel.
Pour parcourir plus aisément leur chemin, qui était caillouteux et parsemé de trous, chacun d'eux avait un gros bâton. Mais ils arrivèrent sans encombre à l'auberge. Ils s'assirent à une table et demandèrent des cartes à jouer. Mais, comme ils n'étaient que trois, il en manquait un pour faire leur compte. Ils n'eurent cependant pas de mal à décider un trimardeur qui soupait à l'auberge de se joindre à eux. Ils s'amusèrent beaucoup : les uns gagnaient et les autres perdaient, mais pour consoler ceux qui perdaient trop, ils se payaient de nombreux verres, et la bonne humeur ne faisait pas défaut.
Après être restés un peu plus de deux heures à jouer, ils décidèrent de retourner chez eux : le lendemain, ils avaient tous trois beaucoup à faire. Ils payèrent l'aubergiste, prirent congé de leur partenaire du hasard, et repartirent dans la nuit au milieu des tourbillons de vent. Arrivés près de la Croix-Rouge, ils virent un cavalier qui montait un cheval fringant. Lorsqu'il parvint à leur hauteur et qu'il les aperçut, il s'arrêta et descendit de son destrier.
« Vous vous en allez déjà, camarades ? leur demanda-t-il. »
« Oui, monsieur, répondirent-ils. I1 commence à se faire tard et nous avons beaucoup de travail demain matin. »
« Allons ! allons ! reprit le cavalier. II faut prendre du bon temps avant de se remettre au travail. I1 n'est pas si tard que vous le pensez. Moi, j'ai l'intention de jouer un bon moment. Si vous m'accompagnez à l'auberge, je m'engage à vous payer tout ce qui sera bu. Les trois camarades se concertèrent et, comme ils étaient un peu surexcités par la boisson, ils finirent par accepter. »
« Oui, dit encore le cavalier, mais il faut que l'un d'entre vous reste pour garder mon cheval. Qu'il soit sans crainte, je lui paierai largement sa peine lorsque nous reviendrons ici. »
C'est le plus jeune qui resta. Les deux autres rebroussèrent chemin joyeusement en compagnie de l'homme. Dès qu'ils furent à l'auberge, ils se mirent à jouer avec plaisir, ayant repris avec eux le trimardeur qui avait été précédemment leur partenaire. Mais le cavalier perdait beaucoup, et les deux camarades ne se sentaient plus de joie. Tout à coup, une carte tomba sur le sol. Un des frères se baissa pour la ramasser.
« Non, dit le cavalier, c'est moi qui l'ai lâchée, c'est moi qui la ramasserai. »
C'est ce qu'il fit, mais il était trop tard. En se baissant, l'un des camarades avait pu remarquer les pieds du cavalier : ces pieds étaient fourchus comme ceux d'un ruminant. II en fut tout bouleversé mais s'efforça de ne rien en laisser paraître.
« Je crois qu'il est l'heure de nous en aller ! dit-il en se levant. Finissons cette partie, et nous rentrerons à la maison. »
« Que non ! que non ! s'écria le cavalier. »
« - Je dis qu'il est temps de finir ! » répondit l'autre d'un ton qui exprimait bien sa détermination. Le cavalier, quant à lui, n'avait nulle envie de repartir. II leur dit qu'il allait leur payer encore à boire et qu'il était disposé à jouer toute la nuit s'il le fallait, car il ne pouvait pas abandonner ainsi alors qu'il n'avait cessé de perdre. Mais le jeune homme qui avait aperçu ses pieds fourchus lui répéta sèchement, d'une voix déformée par la colère :
« Je vous dis que nous finissons et que nous rentrons chez nous ! »
-« Non, encore une fois non ! s'entêta le cavalier. »
« Alors, je jette les cartes au feu ! s'écria le jeune homme. »
« Si c'est ainsi, finissons la partie et rentrons, puisque vous ne voulez pas rester. »
Le cavalier paraissait de fort mauvaise humeur, et il perdit encore cette dernière partie. I1 se leva avec les autres et ils sortirent tous dans la nuit noire. Mais à la Croix-Rouge, pendant tout ce temps, celui des trois qui gardait le cheval s'était assis sur un bloc de pierre et pensait qu'il aurait bien voulu, lui aussi, continuer à jouer à l'auberge. Et il fut bien surpris quand il entendit le cheval qui lui parla distinctement.
« Tout à l'heure, disait le cheval, quand mon maître reviendra, il proposera de te donner autant d'argent que tu voudras. Mais prends bien garde : n'accepte rien de lui, sinon il t'entraînera jusqu'au plus profond de l'enfer. « Mais, dit le jeune homme, comment le sais-tu et comment se fait-il que tu parles comme un chrétien ? »
« C'est que, dit le cheval, je suis un chrétien qui est condamné à l'enfer parce qu'il a mené une vie dissolue. Le diable m'emmène avec lui chaque nuit lorsqu'il est à la recherche d'âmes pour remplir son enfer puant. Et je suis obligé de le suivre et de le porter. N'oublie pas mon conseil et crois-moi, mon garçon, car je suis ton grand- père. Et ne m'oublie pas dans tes prières ! »
Le jeune homme fut bien étonné d'entendre ces paroles. Mais ses deux camarades revenaient avec le cavalier. Celui-ci, dès qu'il fut arrivé près de son cheval, demanda au garçon de combien était son compte.
« Oh ! rien du tout, répondit le jeune homme. Je suis bien heureux de t'avoir rendu service et je n'attends aucune récompense. »
Le cavalier insista, lui offrant une poignée d'argent, puis une poignée de pièces d'or. Rien n'y fit : le jeune homme demeura intraitable. Alors, furieux d'avoir fait une si mauvaise journée, le cavalier sauta sur son cheval, le cravacha sauvagement et s'élança dans la nuit. Des étincelles jaillirent sous les sabots du cheval, puis celui-ci et son maître disparurent. Le plus jeune des camarades raconta aux deux autres ce que lui avait révélé le cheval, et celui qui avait vu les pieds fourchus du cavalier en fit également part à ses amis.
« Nous l'avons échappé belle ! dirent-ils alors, car si nous avions joué plus longtemps avec le diable, il aurait réussi à nous entraîner en enfer. »
Ils se remirent en route et se hâtèrent de regagner leur maison. Mais ils se promirent bien de ne plus aller jouer aux cartes à l'auberge avec des inconnus.
LE DON DU FANTÔME:
Dans l'ancien temps, il y avait un homme qu'on appelait Pâidîn Ruadh O'Kelly et qui demeurait au pied de la colline du Petit Nêifin. I1 était marié, mais il n’avait eu qu’un seul enfant, une fille, qui était malheureusement aveugle. Les gens du voisinage appelaient cette fille Nora Dall et murmuraient qu'elle entretenait des rapports avec les fées et les gens des tertres, car on la voyait toujours la tête dressée vers le ciel, comme si elle écoutait des voix que personne ne parvenait à entendre.
I1 faut dire que Pâidîn Ruadh était lui-même bien étrange. I1 ne possédait que deux acres de terre autour de sa maison, et il était très pauvre, car sa récolte de pommes de terre était bien maigre. Mais, chaque nuit, qu'il fit froid ou chaud, humide ou sec, il sortait de chez lui et s'en allait rôder dans la campagne. En fait, il ne savait pas pourquoi il agissait ainsi : quand on lui en demandait la raison, il répondait toujours qu'une force irrésistible le poussait à s'en aller ainsi dans la profondeur de la nuit et qu'il lui était impossible de demeurer immobile et allongé sur son lit. En ce temps-là, les gens croyaient que tous les lutins et les fantômes de la terre sortaient pendant la nuit de Samain' pour gâter les mûres, et, assurément, personne n'aurait mis la moindre mûre dans sa bouche après cette date-là. Mais Pâidîn n'avait pas peur des êtres de la nuit, et ce n'était pas la nuit de Samain qui l'aurait empêché de sortir de chez lui et d'aller très loin à travers les collines.
Donc, une nuit de Samain, Pâidîn sortit de sa maison, comme il en avait l'habitude, et il marcha longtemps jusqu'à ce qu'il arrivât auprès d'une vieille église entourée du cimetière. La lune était dans son plein et elle donnait une belle lumière, car le ciel était sans nuages. Comme il entendait un bruit de branches froissées, Pâidîn regarda en l'air et vit un grand homme qui sautait d'arbre en arbre. Tous les cheveux qu'il avait sur la tête se dressèrent tout à coup et il sentit qu'une sueur froide lui coulait sur tout le corps. I1 ne pouvait même pas mettre un pied devant l'autre tant il était saisi de frayeur.
Le fantôme dans un chuintement d’air, sauta à terre. I1 avait des jambes longues et maigres, et l'on voyait presque à travers son corps. I1 s'arrêta devant Pâidîn et lui dit :
« N'aie pas peur de moi, je ne te ferai aucun mal. Je sais que ton courage est grand et c'est pourquoi je vais te faire voir la troupe de fées de Connaught qui joue à la balle contre la troupe des fées de Munster au sommet de la colline du Grand-Nêifm. Je ne pense pas que tu puisses le regretter. »
Sur ce, il saisit Pâidîn par les deux mains, le jeta sur son dos comme on jette un sac plein d'orge, sauta sur l'arbre et, ensuite, de branche en branche, parvint au sommet du Grand-Nêifin. I1 déposa doucement Pâidîn sur un rocher. La troupe des fées de Connaught ne tarda pas à arriver. Elle fut suivie par celle des fées de Munster. Elles se mirent à jouer à la balle en présence de Pâidîn et du fantôme, et jamais un homme vivant n'avait contemplé un spectacle aussi amusant. Pâidîn riait aux éclats et en prenait mal aux côtes. À la fin, le roi des fées de Connaught s'écria :
« Fantôme des arbres ! selon toi, quelle est la troupe qui a gagné la partie ? »
« Assurément, c'est la troupe des fées de Connaught ! répondit le fantôme. »
« Tu es en train de dire un mensonge ! s'écria alors le roi des fées de Munster. Nous allons combattre avant d'abandonner la partie à ceux de Connaught ! »
Ils commencèrent à lutter les uns contre les autres, et ce ne fut pas une mince affaire : ils ne se battaient pas pour rire et bien des crânes furent brisés, ainsi que des bras et des jambes, à cette occasion. L'herbe de la colline en devint toute rouge de sang. À la fin, le roi des fées de Munster leva les bras au ciel et s'écria d'une voix forte : « Paix ! je vous cède la victoire cette fois-ci, mais je vous assure que nous combattrons de nouveau pendant la nuit de Beltaine ! » Alors, le fantôme des arbres dit aux deux rois :
« Payez cet homme que j'ai amené ici, car, sans sa présence, vous n'auriez pas pu jouer à la balle. »
« C'est juste, dit le roi des fées de Connaught. Je vais lui donner une bourse remplie de pièces d'or. »
« Je ne serai pas en reste, dit le roi des fées de Munster. Je lui donnerai, moi aussi, une bourse remplie de pièces d'or ».
Tous deux s'approchèrent de Pâidîn et lui tendirent chacun une bourse. Puis, brusquement, les deux troupes disparurent.
« Te voici avec beaucoup d'argent maintenant, dit le fantôme à Pâidîn. Y a-t-il autre chose que tu aimerais avoir ? »
« Oui, en vérité, répondit Pâidîn. J'ai une fille qui est aveugle de naissance, et je voudrais bien qu'elle retrouve la vue. »
« Ce n'est pas difficile. Elle verra le soleil demain, avant qu’il ne se couche. Mais il faut que tu suives mon conseil. I1 y a un petit buisson qui pousse sur la tombe de ta mère. Prends-en une épine et enfonce-la derrière la tête de ta fille. Elle y verra aussi bien que toi. Mais si jamais tu dévoiles ton secret à n'importe quel être humain, elle redeviendra aveugle pour toujours. I1 est temps à présent de quitter cet endroit, car, avant que tu retournes chez toi, je voudrais te montrer ma demeure. »
I1 prit Pâidîn par les deux mains et le jeta sur son dos, comme la première fois, et il se remit à sauter de branche en branche jusqu'à ce qu'il eût regagné le grand arbre, près de la petite église, au milieu du cimetière. Il déposa doucement Pâidîn au pied de l'arbre, puis il souleva l'arbre, découvrant ainsi un grand trou dans la terre.
« Suis-moi » dit le fantôme en s'engageant dans l'ouverture. Ils descendirent un bel escalier de pierre et arrivèrent à une grande porte. Le fantôme ouvrit la porte et ils entrèrent. Quand Pâidîn regarda autour de lui, il vit un grand nombre de gens qu'il avait connus autrefois et qui, depuis, étaient morts, tant de sa famille que de son voisinage, et cela depuis bien des années. Quelques-uns souhaitèrent la bienvenue à Pâidîn et lui demandèrent quand et comment il était mort.
« Mais je ne suis pas encore mort ! » leur répondit-il.
« Tu plaisantes ! s'écrièrent-ils. Si tu n'étais pas mort, tu ne serais pas ici au milieu de la troupe des trépassés. »
« Ne crois pas ces gens-là, dit le fantôme, car ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Tu as encore une longue vie devant toi. Viens avec moi, maintenant, avant que tu retournes chez toi. Je vais te donner un petit pot : à n'importe quel moment, quand tu auras besoin de nourriture et de boisson, frappe-le trois fois et prononce ces paroles : « Nourriture et boisson, et gens de service ! » Tu auras alors tout ce que tu pourras désirer. Mais si jamais tu te sépares de ce pot, tu t'en repentiras. Je vais également te donner un petit sifflet : n'importe où que tu sois, si tu es dans la détresse et le danger, souffle dedans, et tu seras secouru. Mais, sur ton âme, ne t'en sépare jamais, car tu t'en repentirais amèrement. »
Là-dessus, il reprit Pâidîn par les mains, le mit sur son dos et le reconduisit sur la route qui menait à sa maison. I1 le laissa à un carrefour et lui dit encore :
« Sur ton âme, ne raconte à personne ce que tu as découvert cette nuit, car tu aurais à t'en repentir, et je ne pourrais plus rien pour toi… »
Pâidîn s'en retourna chez lui, à la pointe du jour, et sa femme lui demanda où il avait passé la nuit. I1 répondit simplement qu'il n'avait pas flâné, mais il déposa le petit pot sur la table et prononça les paroles « Nourriture et boisson et gens de service ».Rien ne se produisit. Pâidîn était sur le point de maudire le fantôme qui lui avait raconté des mensonges, quand il se souvint qu'il avait omis de frapper les trois coups sur le pot. Il donna donc trois coups avant de prononcer les paroles magiques et, aussitôt, deux jeunes femmes sautèrent hors du pot, mirent la table et y placèrent toutes sortes de choses bonnes à boire et à manger. Pâidîn, sa femme et aussi Nora Dall mangèrent et burent tout leur content, et quand ils eurent fini, les deux jeunes femmes desservirent la table, rangèrent tout soigneusement et rentrèrent dans le pot où elles disparurent immédiatement. Alors Pâidîn dit à sa femme :
« Nora ne sera plus longtemps aveugle. Je vais la guérir sans retard, mais je t'en prie, ne me demande pas de renseignements à ce sujet, car il m'est interdit de t'en donner ! si je le faisais, elle redeviendrait aveugle comme avant. »
« Tu te moques de moi ! s'écria la femme. Tu sais bien qu'elle est aveugle de naissance et que personne n'y peut rien ! »
« Attends de voir, dit Pâidîn, et tu parleras autrement. »
I1 sortit aussitôt de sa maison et s'en alla dans le cimetière. I1 ne s'arrêta pas tant qu'il ne fût arrivé près de la tombe de sa mère. I1 y avait en effet un buisson épineux qui se développait au-dessus de la tombe. Pâidîn cueillit une épine et retourna chez lui. I1 saisit Nora et il enfonça l'épine qu'il venait de prendre dans la nuque de sa fille. Celle-ci poussa un grand cri et dit : « Je vois tout ! »
La mère fut saisie de stupeur et pouvait à peine croire à ce prodige. Quand elle eut pleuré de joie, elle dit à Pâidîn:
« L'amour et la chaleur de mon cœur, c’est toi, Pâidîn, mon époux. Tu es vraiment l'homme le meilleur que je connaisse au monde ! »
Le bruit se répandit dans le voisinage que Nora Dall n'était plus aveugle et ne méritait plus son nom. Les gens en étaient bien étonnés. Mais le bruit se répandit aussi que Pâidîn était devenu riche. Or, pour qu'il fût devenu fiche, il fallait bien qu'il fût de connivence avec les fées et dryades, c'était évident. On commença à raconter des histoires à propos de Pâidîn, et nombreux furent ceux qui l'envièrent et qui voulurent lui causer du tort. Certains finirent par dire qu'il n'était pas juste qu'il fût en vie, et ils imaginèrent un complot pour le tuer. Heureusement, parmi eux, il y avait un homme qui ne voulait pas qu'il arrivât du mal à Pâidîn. C'était son propre frère, et il vint le prévenir de ce qui se tramait.
Pâidîn ne se troubla pas. Il mit le sifflet à sa bouche et souffla dedans. Peu de temps après, il entendit murmurer à son oreille :
« Sors de ta maison et cueille les herbes qui sont dans ton jardin, le long du mur de ta grange. Manges-en tant que tu pourras et distribue le reste à ta femme et à ta fille pour qu'elles fassent de même. Chacun de vous trois aura autant de fois la force d'un homme qu'il y a de cheveux sur vos têtes. Avec le maillet qui est sur le mur de ta maison, tu peux vaincre tout ce qu'il y a d'hommes dans l'ensemble de ta paroisse. Mais prends bien soin de faire manger ces herbes à ta femme et à ta fille, et surtout ne révèle à personne les secrets dont tu disposes. »
Au matin suivant, les hommes et les femmes du village vinrent pour tuer Pâidîn. Ils répétaient partout que Pâidîn était un homme-fée et qu'il tenait sa richesse du grand diable d'enfer. Ils entourèrent la maison de Pâidîn et dirent que, s'il ne sortait pas, ils brûleraient la maison au-dessus de sa tête. Pâidîn vint à la porte, leur dit de retourner chez eux et de le laisser en paix, car il n'avait commis aucun tort envers eux. Mais ils étaient si exaltés et si furieux que rien ne pouvait les satisfaire, hormis le meurtre de Pâidîn. Ils se lancèrent à l'assaut de la maison, espérant y mettre bientôt le feu.
Mais Pâidîn saisit le maillet, sa femme un manche de bêche et sa fille un ribot de baratte, et tous trois se ruèrent contre leurs assaillants. Ils ne furent pas longtemps à les mettre en déroute, laissant derrière eux une bonne partie des leurs, le crâne fendu ou les os rompus. Et, depuis ce jour, les habitants du village se gardèrent bien de le provoquer ou de lui causer le moindre tort.
Ainsi vécurent heureux Pâi- dîn, sa femme et sa fille. Mais comme tout a une fin, il fallut bien qu'un jour la femme de Pâidîn parlât du petit pot à l'une de ses voisines. Celle-ci, bien qu'ayant promis le secret sur cette affaire, ne put s'empêcher d'en parler à une autre femme, de sorte que l'histoire, de bouche à oreille, parvint au seigneur qui possédait la terre. Celui-ci vint trouver Pâidîn et lui dit :
« J'ai entendu raconter des merveilles au sujet d'un petit pot que tu as. Montre-le-moi, ou sinon, je te fais brûler pour sorcellerie» Pâidîn ouvrit son coffre et en sortit le petit pot que lui avait donné le fantôme.
« Fort bien, dit le seigneur, mais qui me prouve que tout cela n'est que vantardise. Montre-moi la vertu qui est dans ce pot. »
Pâidîn frappa trois coups sur le pot et prononça les paroles qu'il fallait. Aussitôt, les deux jeunes femmes sautèrent hors du pot et mirent la table, avec la nourriture et la boisson par-dessus, devant Pâidîn et le seigneur.
« Sur ma foi ! dit celui-ci, voilà un pot qui est bien utile. Et puisque je suis ton seigneur, il serait juste que tu me le prêtes ! je dois recevoir des gentilshommes un jour de la semaine prochaine, et je pourrai ainsi les traiter comme il se doit. »
Pâidîn réfléchit à ce qu'il convenait de faire. I1 était bien ennuyé, car il ne pouvait guère refuser son assistance à son seigneur.
« Ce pot n'aurait aucune vertu si je n'étais pas présent » dit-il enfin.
« Qu'à cela ne tienne ! » s'écria le seigneur. « Tu peux te joindre à nous et tu seras le bienvenu ! la seule chose que je te demande, c'est d'être bien habillé ! »
Le lendemain, Pâidîn acheta un nouveau vêtement complet et, quand il l'eut mis, il avait si belle allure qu'il s'en fallut de peu que sa femme et sa fille ne le reconnussent point. Mais elles ne purent s'empêcher de l'admirer. Le jour dit, au petit matin, il prit avec lui son petit pot et alla jusqu'à la maison du seigneur. I1 y avait là une grande quantité de gentilshommes venus de tout le pays avoisinant. Le seigneur fit entrer Pâidîn et son petit pot dans le grand salon.
« Fais préparer de la nourriture et de la boisson afin que je sache s'il y en aura assez pour rassasier ces gentilshommes. »
Pâidîn frappa trois coups sur le pot et prononça les paroles qu'il fallait, en n'oubliant pas d'ajouter « et les gens de service ! » Sur-le- champ, six jeunes femmes sautèrent hors du pot. Elles dressèrent une belle table et y disposèrent toutes sortes de choses, les meilleures qu'on eût pu trouver à la cour d'un roi. Le seigneur fit alors annoncer que le repas était prêt. Les gentilshommes qu'il avait invités furent pleins d'admiration quand ils virent la belle table et tout ce qui se trouvait dessus. Ils mangèrent et burent à satiété, mais bientôt un sommeil lourd s'empara d'eux. Quand ils s'éveillèrent, le toit de la maison avait disparu sans qu'on pût savoir ce qu'il était devenu. Ils se demandèrent ce qu'ils étaient venus faire en cet endroit dévasté et s'en retournèrent chez eux furieux contre le seigneur qu'ils accusaient de s'être moqués d'eux.
Quant à Pâidîn, il était bien le plus ennuyé de tous. Car il eut beau chercher son petit pot, ainsi que le sifflet dont il ne se séparait jamais, il ne les trouva pas, et il s'en retourna chez lui, honteux et confus. Il redevint aussi pauvre qu'il l'avait été. Pendant que lui- même, le seigneur et tous ses invités étaient plongés dans le sommeil de l'ivresse, les fées étaient venues et avaient emporté le tout. Ainsi tomba le malheur sur Pâidîn parce qu'il n'avait pas su garder le secret sur les choses merveilleuses dont lui avait fait don le fantôme des arbres.
LA MEIGA ET LE PECHEUR:
À Corcubion, non loin du cap Finisterre, là où sont les extrémités du monde, il y avait un pêcheur qui était jeune et beau et dont toutes les filles du pays voulaient devenir la femme. Mais le pêcheur n'était pas pressé de se marier. I1 menait tranquillement sa vie, ne travaillant que pour pouvoir vivre honorablement et ne pensait nullement à thésauriser pour assurer sa vieillesse.
Un jour qu'il était allé rendre visite à des parents dans une ferme éloignée et qu'il revenait à pied sur un sentier, il rencontra une meiga qui était assise sur un tronc d'arbre. I1 la salua aimablement comme il faisait chaque fois qu'il rencontrait une femme. Pourtant il savait bien que c'était une meiga, car elle avait des yeux trop clairs pour appartenir à la race des hommes.
-« Où vas-tu, beau garçon ? dit-elle ».
-« Je rentre chez moi, répondit-il. »
-« Tu rentreras chez toi quand je le voudrai, dit la meiga. I1 faut d'abord que tu me promettes de m'épouser. »
Il la regarda attentivement. Elle était jeune et très belle, mais c'était une meiga. I1 savait bien qu'il n'était pas possible d'épouser une femme de cette sorte.
-« Je n'ai nulle intention de me marier, répondit le pêcheur, que ce soit avec toi ou avec une autre. »
-« Ce sera avec moi et avec nulle autre, dit-elle. Et si tu ne veux pas me promettre de m'épouser, je te rendrai la vie impossible. »
-« Je ne te promettrai rien du tout ! s'écria le pêcheur. »
Et, sans plus attendre, il se remit à marcher et retourna chez lui. Là, il se mit en devoir d'allumer le feu dans la cheminée pour préparer son repas du soir. Mais il eut beau mettre du bois sec dans le foyer et battre le briquet, il ne put réussir à éclairer son feu. De guerre lasse, il mangea froid et se coucha tôt. Le lendemain, il se leva et se prépara pour aller en mer. I1 prit ses filets, porta ses rames sur son épaule et se dirigea vers le port. I1 détacha sa barque et s'en alla pêcher.
I1 faisait beau et il y avait très peu de vent. Bientôt le pêcheur sentit une torpeur peser sur sa tête. I1 cessa de pêcher et s'allongea dans sa barque, se disant qu'un petit somme lui ferait du bien. I1 dormit presque toute la journée. Il se réveilla tout à coup en sentant que quelqu'un lui tâtait les jambes et disait tout bas :
-« Oh ! les bonnes petites jambes ! »
Puis il sentit qu'on lui palpait les cuisses. Et la même voix mur- murait :
-« Oh ! les bonnes petites cuisses ! »
Il se redressa, mais il ne vit personne. I1 était seul sur sa barque et la barque était ancrée dans une anse rocheuse, à l'écart de tout. Mais il n'y avait âme qui vive sur le rivage, et le pêcheur se trouvait fort perplexe. Tout à coup, il entendit la même voix dire, beaucoup plus fort :
-« Apportez-moi la hache que je lui coupe les jambes et les cuisses ! »
Le pêcheur suait de peur, mais il ne souffla pas un mot. Et pourtant, la voix recommençait à se faire entendre :
-« Oh ! les bonnes petites jambes ! Oh ! les bonnes petites cuisses ! »
Et cela de plus en plus fort. Et bientôt, ce fut une voix de tonnerre qui résonna :
-« Apportez-moi la hache ! apportez-moi la hache ! »
À ce moment-là, quelque chose sauta hors du bateau et se mit à nager à grandes brasses, comme un poisson. Le pêcheur ne comprenait pas ce qui arrivait. I1 attendit sans bouger et sans rien dire. Enfin, quand le bruit disparut, il se glissa lui-même hors de la barque et regagna le rivage. Là, il regagna sa maison en toute hâte, sans attendre que le phénomène revînt. Mais il avait eu tellement peur qu'il en fut malade pendant quinze jours. Quand il fut guéri, il décida de retourner à la pêche. Mais dès qu'il fut sortit de sa maison, il rencontra la meiga. Elle était assise sur un rocher, sur le bord du chemin et elle le regardait avec des yeux brillants.
-« Bonjour à toi, mon garçon, dit-elle. As-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé l'autre jour ? Vas-tu me promettre de m'épouser ? »
-« Je ne promets rien du tout à personne ! » s'écria le pêcheur de fort mauvaise humeur. Et il s'en alla vers le port. I1 prit sa barque pour pêcher dans l'estuaire. Mais comme il se penchait au dessus de la surface de l’eau afin de voir s'il y avait du poisson, il découvrit, au fond de la mer un vieux coffre délabré qui laissait échapper des monceaux de pièces d or étincelant de toutes parts.
Sans perdre un instant, il jeta l’ancre et, se dépouillant de ses vêtements, il plongea. Quand il arriva sur les pièces d'or qu'il voyait, il tendit ses mains et en ramassa deux pleines poignées. Alors, il remonta vite jusqu'à sa barque et y déposa son butin. Mais à sa grande stupeur, il vit que ce n’étaient que des cailloux qui se trouvaient dans la barque.
-« Je me suis trompé ! s'écria-t-il. Dans ma hâte, j'ai ramassé n'importe quoi.I1 regarda sous la mer et y vit encore le coffre chargé pièces d or qui en débordaient. I1 plongea de nouveau, mais cette fois, il avait pris soin d'emporter un sac qu'il avait dans sa barque. Vite, une fois arrivé au fond de la mer, il remplit le sac et revint à la barque. Après s'être hissé à bord, il reprit sa respiration et déversa le contenu du sac dans la barque. Mais ce n'étaient que des cailloux. Alors il entendit une voix qui disait tout bas, puis de plus en plus fort :
-« Qui veut trop n'a rien ! qui veut trop n'a rien ! qui veut trop n'a rien ! »
Le pêcheur avait beau regarder autour de lui, il n'y avait personne dans les environs. I1 était seul sur cette partie de la côte, et seules les mouettes tournoyaient en espérant récolter quelques-uns des poissons qu'il pêcherait. Mais il n'avait plus envie de pêcher. I1 retourna au port et reprit le chemin de sa maison. Cependant il était tellement déçu parce que les pièces d'or qu'il avait vues n'étaient que des cailloux qu'il en attrapa les fièvres et qu'il resta quinze jours malade dans son lit.
Quand il fut guéri, il décida d'aller passer la soirée à l'auberge. Il sortit de sa maison et, à l'entrée de la ville, il rencontra la meiga. Elle était assise sur un banc et elle était plus belle que jamais. Mais ses yeux étaient si brillants qu'on avait peine à soutenir son regard tant il brûlait et tant il faisait mal.
-« Veux-tu m'épouser ? » demanda la meiga.
-« Je n'épouserai personne ! » répondit le pêcheur. Et il s'en alla droit à l'auberge. I1 y but beaucoup en compagnie de ses amis. Il était très tard quand il voulut s'en aller. La nuit
était noire. Heureusement, il connaissait parfaitement le chemin qui menait à sa maison. Or, il était presque arrivé quand il aperçut une belle lumière qui semblait surgir de la terre. I1 s'approcha et se pencha pour examiner ce que c'était. I1 vit alors un couloir qui s'ouvrait sous la terre et qui semblait devenir de plus en plus large. Intrigué, il voulut en savoir davantage. I1 s'engagea dans le trou, suivit le couloir et déboucha dans une vaste salle où la lumière surgissait inexplicablement de toutes les parois. Et pourtant, il n'y avait rien dans cette salle, pas même la plus petite trace d'une lampe qui aurait pu provoquer cette lumière. I1 en était là de ses réflexions quand il se sentit saisi aux jambes et au bras. Quelque chose qu'il ne voyait pas le tenait et l'obligeait à se coucher sur le sol. Et une voix dit doucement :
-« Oh ! les bonnes petites jambes ! »
Une autre voix sembla répondre : -« Oh ! les bonnes petites cuisses ! »
La première voix reprit :-« Oh ! les bons petits bras ! »
La seconde voix dit encore :-« Oh ! les bonnes petites mains ! »
Le pêcheur était terrifié. Il tentait de se remettre sur pieds, mais il ne le pouvait pas, plaqué qu'il était au sol par des mains qu'il ne voyait pas, mais qui semblaient très puissantes. Alors, une troisième voix dit d'un ton beaucoup plus fort :
-« Oh ! la bonne petite tête ! Oh ! la bonne petite tête ! »
Mais ce qui ajouta à la terreur du pêcheur, ce fut de voir une hache se promener dans les airs et se diriger vers lui. La hache tournoya au-dessus de sa tête et l'être invisible qui la maniait semblait vouloir lui couper la tête.
-« Au secours ! » cria le pêcheur.
Alors il vit la meiga qui s'approchait. Elle saisit la hache de sa main blanche, et quand elle l'eut saisie, la hache disparut. Et le pêcheur se sentit délivré des mains invisibles qui le maintenaient au sol. I1 se redressa et regarda la meiga. Elle était plus belle que jamais et ses yeux encore plus brillants que les autres fois. Elle souriait et regardait le pêcheur avec beaucoup de douceur. Le pêcheur était soulagé de la trouver près de lui. Elle venait de le délivrer d'une situation atroce et il espérait bien qu'elle le ferait sortir de cet étrange endroit où il n'aurait jamais dû pénétrer.
-« Veux-tu m'épouser ? » demanda-t-elle. Le pêcheur ne s'entendit même pas répondre.
- Au secours ! cria le pêcheur. Alors il vit la meiga qui s'approchait. Elle saisit la hache de sa main blanche, et quand elle l'eut saisie, la hache disparut. Et le pêcheur se sentit délivré des mains invisibles qui le maintenaient au sol. I1 se redressa et regarda la meiga. Elle était plus belle que jamais et ses yeux encore plus brillants que les autres fois. Elle souriait et regardait le pêcheur avec beaucoup de douceur. Le pêcheur était soulagé de voir que la meiga se trouvait là. Elle venait de le délivrer d'une situation atroce et il espérait bien qu'elle le ferait sortir de cet étrange endroit où il n'aurait jamais dû pénétrer.
-« Veux-tu m'épouser ? » demanda t-elle.
Le pêcheur ne s'entendit même pas répondre. -« Oui, dit-il, je le veux bien. »
Le jeune épousa la meiga à ce qu'on raconte, et il quitta son métier de pêcheur. I1 s'établit avec sa femme sur une colline, au milieu des bois et personne ne sut jamais de quoi ils vécurent. Mais ils eurent de nombreux enfants, et, actuellement encore, ce sont des descendantes de la meiga et du pêcheur que les hommes rencontrent parfois, le soir, quand l'obscurité envahit la terre. Et, à chaque fois, ces femmes luminescentes demandent aux voyageurs:
-« Veux-tu m'épouser ? »
LA PRINCESSE DU CHATEAU ENCHANTE:
II y a longtemps, très longtemps, vivait un prince irlandais. Quand vint pour lui le temps de prendre épouse, comme l'y incitaient beaucoup de ses conseillers, il partit vers l'est du monde, car c'est là qu'il désirait trouver une princesse. Personne ne sait si une certaine beauté l'attirait déjà en ces lieux ou s'il s'y rendait sur la recommandation d'un de ses conseillers. Lui seul connaissait la raison de son entreprise. Il voyagea longtemps avant de trouver celle qui l'attendait. Mais de dures épreuves le guettaient.
La belle princesse habitait un château situé au sommet d'une immense falaise et, autour du château, de jour comme de nuit, tournaient d'énormes roues. Personne ne pouvait entrer dans le château tant que ces roues tournaient. Le prince irlandais arriva au pied de la forteresse, il en fit le tour et l'examina de tous côtés. Puis il secoua la tête: « Pourquoi suis-je venu jusqu'ici? » soupira-t-il tristement. « Pourquoi ai-je accompli un si long voyage, alors que je ne puis entrer dans ce château et y réjouir mes yeux de la vue de ma belle princesse? »
Il allait s'en retourner quand un volet s'ouvrit sur un mur de la forteresse. Le prince leva la tête et aperçut la plus belle jeune fille qu'il eût jamais vue. II n'avait même jamais rêvé en rencontrer une aussi belle. Il s'agissait de la fille du roi de l'est du monde. Elle vivait avec ses servantes dans une tour protégée par ces énormes roues tournantes. Le roi les avait faites installer là afin que personne ne puisse atteindre sa fille, tant qu'il n'aurait pas lui-même donné l'autorisation qu'elle se mariât avec le puissant souverain voisin. Mais le monarque en question ne se contentait pas d'être riche et puissant. Il était aussi vieux et repoussant et la princesse ne voulait pas de lui pour époux.
Tristement, la princesse contempla le prince d'Irlande. Quand leurs regards se rencontrèrent, le prince se figea sur place comme s'il avait pris racine en cet endroit. Au bout d'un long moment, il dit : »Je retourne en Irlande, mais je te promets de ne pas avoir de repos tant que je n'aurai pas trouvé dans mon pays un enchanteur assez puissant pour arrêter le mouvement de ces énormes roues. Mais je te demande de me faire le serment de m'attendre jusque-là. »
« II n'existe pas de semblable enchanteur en Irlande », dit une voix près du prince. Celui-ci se retourna et aperçut à ses côtés un maigre vieillard. « Penses-tu ? » protesta-t-il. « II existe beaucoup d'enchanteurs en Irlande. »
« Tu as peut-être raison, mais je te dis pourtant qu'à part le roi de l'est du monde, il n'y a qu'un seul homme pour savoir comment arrêter ces roues. Et il ne se trouve pas en Irlande. » « Qui est-ce? Où le trouverai-je? » demanda le prince. « Tu n'auras pas besoin de le chercher. C'est moi », répondit gravement le vieillard.
« Et qui es-tu? » insista le prince.
« Que t'importe? Autrefois, je fus l'ami du roi de l'est du monde. Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis bien longtemps, mais nous avons eu le même maître en sorcellerie. Je l'ai toujours surpassé par mes pouvoirs, et je pense le faire encore aujourd'hui en empêchant ces énormes roues de tourner, si tu me le demandes. »
« Je t'en prie, arrête-les! » supplia le prince d'Irlande. « Et de surcroît, je te prie de m'apprendre qui tu es, afin que je sache à qui donner ma gratitude et ma récompense. »
« Je suis le puissant enchanteur Thuraoi, d'Irlande. Et je ne désire rien en récompense, si ce n'est l'autorisation de prendre dans ce château ce que bon me semblera. »
« Je te remercie de ton aide, mais ce château n'est pas à moi », répliqua le prince.
« Cela n'a pas d'importance », s'écria la princesse de sa fenêtre, « cher Thuraoi, si tu nous aides à arrêter ces roues et à faire entrer le prince dans ce château, tu pourras y prendre tout ce que tu voudras. Tout ce qui t'y plaira sera à toi. »
« Vous me le promettez tous deux? » insista Thuraoi.
« Nous le promettons », répondirent le prince et la princesse d'une seule voix. Alors, l'enchanteur ordonna au prince de s'éloigner avec lui de neuf pas des énormes roues. Quand ils eurent accompli ces neuf pas, les énormes roues s'arrêtèrent de tourner. Le prince se précipita à l'intérieur du château et la princesse courut à sa rencontre.
Le roi de l'est du monde fut fort effrayé quand il remarqua que les roues venaient de s'arrêter. Il appela ses gardes, tira son épée et alla regarder quel était l'intrus qui avait surpassé ses pouvoirs. Quand il aperçut l'enchanteur Thuraoi, son épée lui tomba des mains en signe d'impuissance.
« Que venez-vous faire en ces lieux ? » demanda-t-il au prince quand il fut revenu de sa surprise.
« Je suis prince d'Irlande et je suis venu chercher ta fille pour en faire mon épouse. Le puissant enchanteur Thuraoi m'a aidé et, en échange, ta fille et moi lui avons promis qu'il pourrait prendre dans le château ce qui lui plairait le plus. »
« Est-ce vrai, ma fille? » demanda le souverain à la princesse.
« Oui, père », confirma-t-elle en souriant au prince.
« Prends donc ce que tu veux dans ce château », soupira le roi en se retournant vers l'enchanteur.
« J'ai déjà choisi », répondit Thuraoi. « Ce qui me plaît le plus dans tout ce château, c'est ta fille. A partir de maintenant, elle est mienne. »
Le roi, la princesse et le pauvre prince tressaillirent, mais il était impossible de revenir sur une promesse. La princesse faillit mourir de désespoir à l'idée qu'elle devrait bientôt épouser le vieil enchanteur. Ses larmes coulèrent quand elle regarda à nouveau le prince: Le contempler ainsi la rendait encore plus malheureuse. Et elle aurait préféré qu'on l'ensevelît sous terre plutôt que d'accorder sa main à ce vieux sorcier.
Par bonheur, le prince réussit à chuchoter à la princesse qu'elle ne devait pas perdre espoir et qu'il essaierait de la délivrer à nouveau. La jeune fille reprit confiance et décida de repousser le jour du mariage autant qu'elle le pourrait.
« Je t'ai promis de te suivre et je tiendrai ma promesse », dit-elle à l'enchanteur. « Mais je te demande de m'accorder une faveur. Je voudrais que tu me conduises, après nos noces, dans un château encore plus beau que celui-ci. Je suppose que tu ne voudrais pas que ta femme vive dans de plus mauvaises conditions que lorsqu'elle était jeune fille? »
« Bien, tu auras bientôt un château selon ton goût », promit l'enchanteur. I1 lui aurait promis la lune et les étoiles, tant il la trouvait belle. « Mes gens se rendront à travers toute l'Irlande pour me rapporter de quoi le construire et l'orner. »
« Retourne en Irlande, mon bien-aimé », demanda la princesse au prince. « Va, et surveille la construction de ce château. Lorsqu'il sera presque achevé, préviens-moi. J'y viendrai avec toute ma suite et je tâcherai de trouver un moyen d'échapper à ce sorcier. »
Le prince d'Irlande obéit. Il se déguisa en barde et s'en alla surveiller la façon dont les géants, au service du sorcier, réunissaient les matériaux nécessaires à la construction du château. Jour après jour, de hautes et épaisses murailles s'élevèrent. Les menuisiers de tout le royaume d'Irlande durent confectionner des tables et des chaises pour les salles du château, les forgerons entrèrent aussi en action, ainsi que les orfèvres qui ciselèrent la plus belle vaisselle d'argent. Les tisserands tissèrent et les femmes brodèrent des tentures, des tapis et des couvertures. Bientôt, tout fut presque prêt et d'une beauté sans pareille.
Un mois avant la fin de l'année, le prince irlandais fit prévenir sa belle princesse, afin qu'elle vînt contempler le nouveau château dont l'achèvement était imminent.
La princesse se mit aussitôt en route pour l'Irlande avec une suite importante. Le vieil enchanteur bondit de joie comme un jeune homme à l'annonce de cette arrivée. Quand les navires du roi de l'est du monde abordèrent les côtes irlandaises, de nombreux curieux accoururent. Au milieu des acclamations, la voix d'un barde s'éleva. La princesse n'avait jamais entendu un chant aussi beau et elle demanda au sorcier :
« Bien-aimé, invite ce barde au château pour qu'il nous réjouisse de ses chansons. »
Pendant la fête, la princesse s'éclipsa un instant pour rejoindre le barde auquel elle chuchota de réunir ses meilleurs combattants sur le flanc de la montagne, en bas du château, et de l'y attendre près du ruisseau.
« Quand il coulera du lait dans le ruisseau, tu sauras que l'instant est venu pour toi et tes troupes de venir à la porte de la forteresse. Je vous y attendrai. »
Le prince d'Irlande obéit et réunit rapidement sa troupe sur le flanc de la montagne, au bas du château. Jour et nuit, ils attendirent au bord du ruisseau pour voir si du lait allait y couler à la place de l'eau. Les jours passèrent, le château continua de grandir et les géants au service du sorcier arrivèrent avec les derniers matériaux nécessaires. Le vieux Thuraoi attendait avec une impatience non dissimulée que les artisans aient fini leur travail, afin de montrer à la princesse qu'il n'existait pas à présent de château plus beau au monde. Pour calmer son impatience, il partit à la chasse.
La princesse choisit cet instant pour dire devant ses servantes qui apportaient le lait fraîchement trait : « Pouah! Ce lait a mauvaise odeur. Jetez-le dans la rivière. Je n'en boirai pas une goutte. Dieu seul sait quel poison s'y trouve! »
Les servantes furent étonnées et tentèrent de convaincre la princesse que ce lait était frais et excellent, que les vaches avaient brouté dans les meilleures prairies, mais en vain. La princesse finit même par se fâcher :
« Jetez donc ce lait dans le ruisseau ou cela ira mal pour vous! »
Les servantes et les valets vidèrent alors tous les récipients à lait dans le ruisseau, car l'enchanteur leur avait formellement ordonné d'obéir aux caprices de la princesse. Lorsque le ruisseau se colora en blanc, le prince d'Irlande et sa suite bondirent pour se rendre à la porte du château. Là, la princesse et son cortège les attendaient déjà.
« Vite, vite », dit-elle à son bien-aimé, « l’enchanteur est à la chasse avec ses gens. Il est temps de s'enfuir! »
Les compagnons du prince tuèrent les gardes du château et bientôt, le prince, la princesse et leurs gens purent s'enfuir. Tard le soir, l'enchanteur rentra de la chasse et trouva le château désert. Les gardes avaient disparu, ainsi que les géants, la princesse et sa suite. Fou de colère, il monta dans la tour, saisit une trompe et sonna pour appeler à l'aide. Mais les géants étaient encore loin. Le temps qu'ils arrivassent jusqu'au château, ils ne trouvèrent plus que leur maître, terrassé par la rage, et ne surent jamais pourquoi il les avait appelés.
Le prince d'Irlande, sa gracieuse princesse et ses fidèles compagnons rentrèrent chez eux sains et saufs et fêtèrent le plus beau mariage qu'on eût jamais vu. Neuf jours durant, la bière et l'hydromel les régalèrent, ainsi que les mets les plus fins. Et ils dansèrent et chantèrent jusqu'à ce que le château de l'enchanteur se fût effondré et que ses pierres eussent roulé au fond de la vallée.